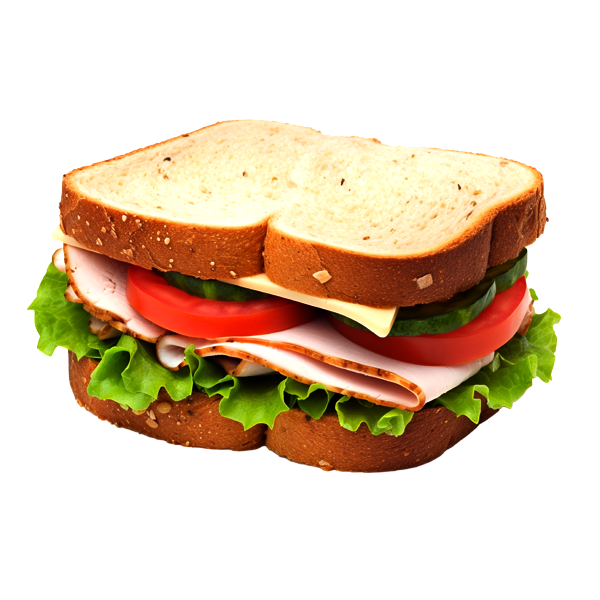

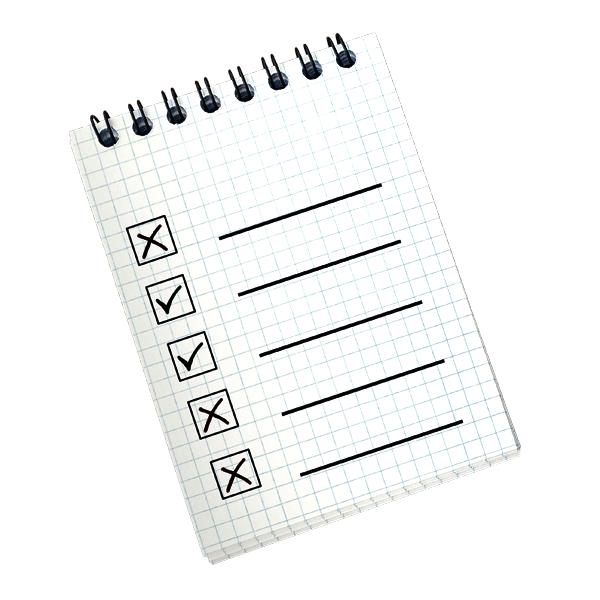



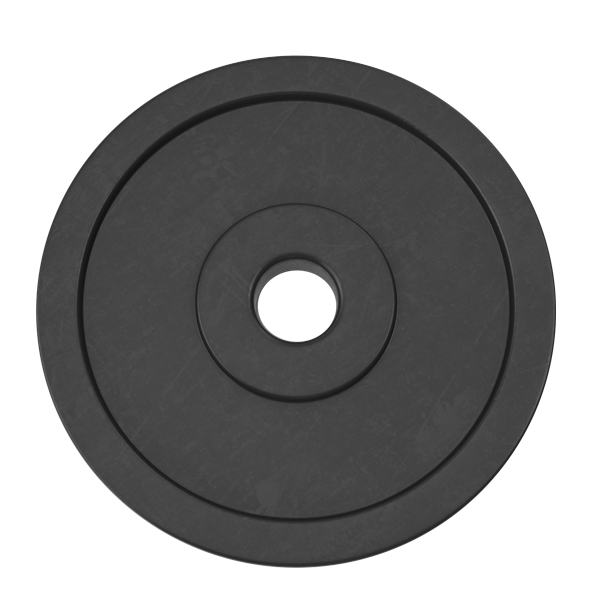

Combien tu benches?
Un enjeu invisible ancré dans la société
La charge mentale, c’est le travail invisible de planification et d’organisation du quotidien, souvent assumé par les femmes. Ce n’est pas un simple déséquilibre individuel, mais un enjeu sociétal, lié à des normes de genre qui perpétuent l’idée que les femmes sont naturellement responsables du foyer. Pour avancer vers une répartition plus équitable, il faut d’abord reconnaître que cette charge est le produit de rôles sociaux ancrés, transmis depuis des générations. Mais elle ne touche pas toutes les femmes de la même manière : la charge mentale s’intensifie lorsque d’autres formes d’oppression s’ajoutent, comme la précarité financière, l’immigration, une situation de handicap ou les responsabilités liées au statut de proche aidant·e. Ces réalités croisées rendent la charge encore plus lourde, plus invisible et plus difficile à déléguer.
- Planifier les repas
- Penser aux cadeaux
- Préparer les valises
- Faire la lessive
- Support émotionnel
- Faire le ménage
47%
de temps en plus : c’est ce que les femmes consacrent aux tâches domestiques chaque semaine par rapport aux hommes.
Enquête sociale générale – ISQ, 2015
64%
des personnes ayant donné 20 heures ou plus de soins par semaine à au moins une personne de leur entourage sont des femmes.
Conseil du statut de la femme, 2018; Statistique Canada, 2018; 2020; 2021
62%
des tâches domestiques sont réalisées par les femmes dans les ménages où les deux conjoint·e·s travaillent à temps plein.
Observatoire de la pauvreté et des inégalités du Québec, 2015
En bref
Des capsules informatives pour y voir plus clair. Comprenez ce qu’est la charge mentale et pourquoi elle repose encore si souvent sur les femmes.
Les tâches bleues
et les tâches roses
Les « tâches bleues » sont généralement associées aux rôles traditionnellement masculins, comme les réparations domestiques, l’entretien du jardin, la gestion financière ou encore des responsabilités extérieures telles que l’entretien de la voiture ou la gestion des assurances. Les femmes, quant à elles, se voient plus souvent attribuer des « tâches roses », comme la planification des repas, le soutien émotionnel, les courses et le soin des enfants.

Visibilité
Les tâches bleues sont généralement plus visibles et reconnues publiquement, comme réparer quelque chose dans le jardin ou gérer les finances familiales. En revanche, les tâches roses sont souvent plus invisibles et sont censées être prises en charge en arrière-plan (par exemple, la planification des repas ou le soutien émotionnel).
Travail Émotionnel
Les tâches roses impliquent généralement plus de travail émotionnel que les tâches bleues. Elles nécessitent souvent de gérer les émotions, d'anticiper les besoins des autres et d'apporter des soins, tandis que les tâches bleues sont davantage axées sur des responsabilités pratiques ou physiques.
Fréquence
Les tâches bleues sont souvent plus épisodiques ou situationnelles, tandis que les tâches roses sont quotidiennes et nécessitent une attention continue. Par exemple, la planification financière ou l'entretien de la voiture peuvent être moins fréquents que la gestion des emplois du temps familiaux ou les courses, qui sont des tâches continues.

Qu'est-ce que cela change?
Bien que les tâches bleues puissent nécessiter un effort cognitif important, elles sont généralement moins fréquentes que les tâches roses et apparaissent plus tangibles ou visibles. Par exemple, réparer quelque chose dans la maison ou gérer les finances familiales demande une grande concentration. Toutefois, ces tâches ont un début et une fin clairs, ce qui les rend moins accablantes mentalement que la charge continue et quotidienne des tâches roses.
Les manifestations d’évitement de la charge mentale
La charge mentale ne se résume pas aux tâches à accomplir, mais à l’énergie constante nécessaire pour penser à tout, tout le temps. Certains comportements du quotidien, souvent banalisés, viennent alourdir cette charge. Ces attitudes, conscientes ou non, aggravent le déséquilibre dans la répartition mentale des tâches. Ce déséquilibre pèse non seulement sur la santé mentale, mais fragilise aussi la relation.

Attente passive
Attendre de se faire dire quoi faire au lieu de prendre l'initiative. Cela met la charge de la planification et de la délégation sur l'autre personne.

Amnésie sélective
Oublier des tâches ou faire semblant de ne pas savoir qu’elles devaient être faites, forçant l’autre personne à s’en souvenir et à les rappeler.

Comparer la charge à de la « surpensée »
Réduire l'effort d'organisation et de planification en disant des choses comme « Pourquoi tu stresses ? Ça va s'arranger. »

Détournement de responsabilité
Dire des choses comme « Dis-moi simplement ce que tu veux que je fasse » au lieu de chercher activement à identifier et à résoudre les tâches soi-même.

Incompétence instrumentalisée
Faire semblant de ne pas savoir comment accomplir une tâche correctement ou l’accomplir volontairement de manière incorrecte, afin que quelqu’un·e d’autre prenne le relais. Par exemple : « Je ne sais pas comment préparer les lunchs des enfants comme toi. »

Prioriser son propre confort
Assumer moins de tâches mentalement exigeantes et se concentrer sur des activités perçues comme plus agréables ou optionnelles, comme tondre la pelouse, qui ne demande pas de planification constante, contrairement à la planification des repas.
Le cercle vicieux de la charge mentale
Le « nag paradox », ou paradoxe de l'insistance, décrit une dynamique où une personne, souvent une femme, doit sans cesse rappeler à son partenaire d’accomplir une tâche domestique. Si elle ne dit rien, la tâche risque de ne jamais être faite. Si elle insiste, elle est perçue comme harcelante. En voulant partager la charge mentale, elle la maintient malgré elle, tandis que l’autre évite toute responsabilité d’anticipation. Ce mécanisme entretient l’inégalité dans la gestion du quotidien.
Inégalités et conséquences
Impacts sur la santé mentale
La charge mentale, lorsqu’elle est constante et inégalement répartie, a des répercussions importantes sur la santé des femmes. L’accumulation invisible de responsabilités entraîne du stress, de la fatigue chronique et un épuisement émotionnel profond. À long terme, cette pression permanente peut causer des troubles du sommeil, comme l’insomnie, et, dans les cas les plus sévères, mener jusqu’à l’épuisement professionnel.
Au Québec, les femmes consacrent 47 % de temps de plus chaque semaine aux tâches domestiques, comparativement aux hommes. De plus, 64 % des personnes qui offrent 20 heures ou plus de soins par semaine à un proche sont des femmes. Ce déséquilibre entraîne une charge mentale accrue, avec des conséquences directes sur leur bien-être physique et psychologique.
La charge mentale a aussi un impact sur la vie de couple ! Elle entraîne souvent une perte de désir et alimente des conflits relationnels.
Reconnaître ces impacts est essentiel : ce n’est pas seulement une question d’organisation, c’est un enjeu de santé publique !

Conséquences au travail
La charge mentale ne s’arrête pas à la porte de la maison : elle poursuit les femmes jusque dans leur vie professionnelle. En effet, 62 % des tâches domestiques sont réalisées par les femmes dans les ménages où les deux conjoint·e·s travaillent à temps plein, ce qui ajoute un poids considérable à leur charge mentale. Cela impacte directement leur bien-être au travail et contribue à maintenir un déséquilibre dans le milieu professionnel.
Beaucoup vivent également avec une culpabilité persistante, convaincues de ne jamais en faire assez — ni à la maison, ni au travail. Cette pression silencieuse freine leur épanouissement professionnel et perpétue ces écarts dans le monde du travail.
Ce phénomène ne se limite pas aux couples : il se manifeste aussi au travail. La charge mentale se fait sentir entre collègues, hommes et femmes, alimentant au quotidien les déséquilibres et inégalités.
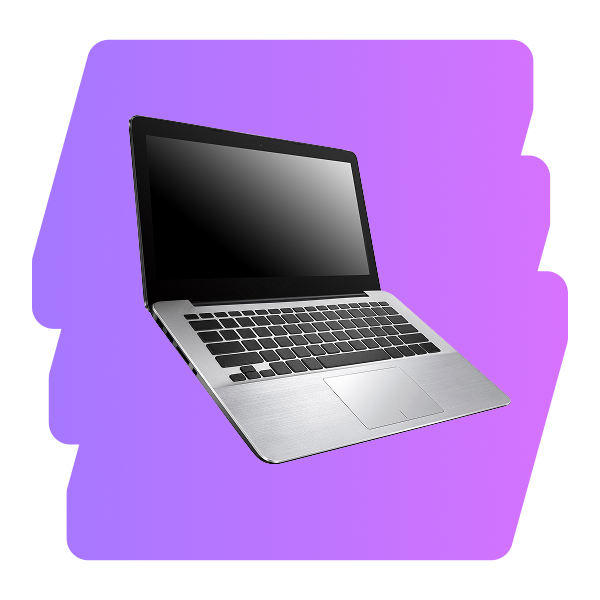
trouver l’équilibre

1. Nommer la charge mentale
Parce que ce qui n’est pas nommé ne peut pas être partagé.
La première étape vers un partage plus équitable, c’est de reconnaître que la charge mentale existe — et qu’elle pèse. Nommer ce travail invisible permet d’ouvrir un dialogue plus clair dans le couple ou la famille : Qui pense à quoi? Qui anticipe? Qui planifie? Mettre des mots sur ces responsabilités rend visibles des gestes souvent minimisés, comme prévoir les rendez-vous médicaux, penser aux lunchs ou organiser les horaires.
2. Établir une vue d’ensemble
On ne peut pas équilibrer ce qu’on ne voit pas dans son ensemble.
Faire une liste complète des tâches du quotidien — visibles et invisibles — permet de prendre conscience de ce qui pèse vraiment sur chacun·e. Cela inclut non seulement les gestes exécutés, mais aussi l’organisation mentale : anticiper les repas, planifier les rendez-vous médicaux, penser aux changements d’horaire ou aux cadeaux d’anniversaire.
Il est aussi important de reconnaître que certaines actions, comme ranger son verre dans le lave-vaisselle, sont des tâches normales qui ne devraient pas être survalorisées ou récompensées.
L’objectif n’est pas seulement de déléguer une action, mais de transférer la responsabilité dans son ensemble : s’approprier la tâche, prendre l’initiative de la planifier et de la réaliser de façon autonome.
Par exemple, « gérer les rendez-vous médicaux des enfants » signifie planifier, prendre rendez-vous, et assurer le suivi — pas simplement accompagner les enfants quand on vous le dit.
3. S'outiller
L’organisation partagée commence par des repères communs.
Pour alléger la charge mentale, il est utile de s’appuyer sur des outils concrets qui rendent la planification visible et partagée. Un calendrier Google commun, des applications comme Trello, Cozi ou OurHome peuvent aider à visualiser les tâches, les répartir plus équitablement et éviter que tout repose sur une seule personne.
Ces outils ne règlent pas tout, mais ils facilitent les suivis et les ajustements continus — essentiels pour maintenir un équilibre durable dans l’organisation du quotidien.
Ressources pour alléger la charge mentale
Découvrez des outils, de l’accompagnement et des références pour vous aider à mieux comprendre, partager et alléger la charge mentale au quotidien.
La charge mentale : intersectionnalité et ressources adaptées
Ressources adaptées aux réalités spécifiques : immigration, aide sociale, handicap, agriculture.
Soutien et accompagnement en Chaudière-Appalaches
Centres-Femmes et Maisons de la famille de la région offrent écoute, accompagnement et groupes de discussion pour briser l’isolement.
Pour aller plus loin
Rapports de recherche, balados, BD et guides pour approfondir votre compréhension de la charge mentale.
Outils pour alléger la charge mentale
Exercices, applications, calendriers partagés et livres pour mieux répartir les responsabilités et organiser le quotidien.
Remerciements
La création de cette section web a été rendue possible grâce à la contribution précieuse de plusieurs femmes et organisations. Leur expertise, leur expérience terrain et leur engagement ont permis de développer un contenu fidèle aux réalités vécues par les femmes à la croisée des oppressions.
Nous remercions chaleureusement :
- Agricultrices Chaudière-Appalaches Est
- Agricultrices Chaudière-Appalaches Ouest
- Association de Défense des Droits Sociaux (ADDS) de la Rive-Sud
- Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud
- Centre-Femmes de Bellechasse
- Les Agricultrices du Québec
- Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford (RPHPRT)
Faites circuler la réflexion
Partagez notre outil d’autoévaluation « Combien tu benches? » à un·e ami·e, un·e collègue ou un·e partenaire. Un outil simple pour amorcer une prise de conscience et lancer le dialogue.
Ce projet a été financé par le secrétariat à la condition féminine

Ce projet est une initiative du Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches
.png)